
Monday, 9 May 2011
MERLEAU-PONTY & LA PROSE DU PHILOSOPHE

Wednesday, 20 April 2011
JOB: LES DESTINS INFINIS DU JUSTE SOUFFRANT

Sunday, 13 March 2011
غسان تويني الحرّ الكريمٍ
Friday, 4 February 2011
DU PEUPLIER AU PÈRE, UN QUINTETTE SALUTAIRE

Jawdat Fakhreddine: Fussûl min sîratî maa alghaym (Chapitres de mon histoire avec les nuages), 95pp, Riad El-Rayess, 2010.
Le propre de la poésie de Jawdat Fakhreddine, c’est une hauteur certaine qui la détache du commun de ce qui s’écrit sous le nom de poésie arabe contemporaine : la pureté de la langue, la maîtrise des rythmes traditionnels réinvestis dans une prosodie moderne, la fidélité à un moi et à une réalité saisis, sans exagération ni boursouflure, dans leur essence et leur dignité fondamentales. Mais à mesure que se suivent les recueils, son œuvre ne se contente pas de réaffirmer ses valeurs, mais porte toujours plus loin sa quête d’elle-même. Le présent livre dont certains poèmes, parus dans les périodiques ou des quotidiens (2007-2010), ont été des événements culturels dans les cercles beyrouthins, vient à point nommé non seulement pour signifier que les Œuvres poétiques ont été trop tôt réunies (Beyrouth, 2006), mais pour marquer une nouvelle borne dans un itinéraire qui ne cesse de se départir de lui-même et de se régénérer.
Le nouveau divan offre un quintette dont chaque poème se saisit d’un thème pour le réélaborer ou se réélaborer à travers lui. Du peuplier au père en passant par les feuilles d’arbre, la neige et le nuage, le périple est long d’autant plus qu’il va des déserts de l’Arabie antique aux villes nord-américaines d’aujourd’hui tout en n’occultant pas l’ancrage au sol natal, un Sud Liban saisi au-delà (ou en deçà ) de la guerre et dans la résistance à toutes les formes de violence. Mais l’ampleur de la traversée est tout entière prise en charge et assemblée par le nombre restreint des « fondamentaux » du chant (la nuit, la terre, la vie, la mort, l’amitié…) et par la mission même de la poésie jamais à ce point exaltée par le poète : « Par elle et en elle, je sens la vie s’étendre et se multiplier de jour en jour. »
L’arbre à la taille haute et à l’écorce lisse est le compagnon de l’auteur, son miroir : « Le peuplier était plus grand que moi quand je me flétrissais/et un peu plus petit que moi quand je m’épanouissais/mais il était comme moi frêle et précaire/et comme moi retenait la trace des blessures. » L’harmonie se tisse entre eux nourrie de la ressemblance physique, de la parenté éthique et formelle, de leurs heurts et renvois dans un milieu commun où guette l’obscurité et sauve le lyrisme: « Quand la nuit m’a promené/ la Terre se révéla peur de gazelle, berceau de mirages, écho de chansons. »
Puis après deux belles œuvres consacrées, la première, aux feuilles mortes et à leurs arbres qui « forment et voilent » les villes dans un « jeu » où le soleil perd toujours, et la seconde à la neige « miracle de la couleur et lumière de l’absence », survient le plus long des poèmes du recueil, celui qui donne à l’ensemble son titre. La thématique du nuage, si présente dans la poésie contemporaine, y est ici travaillée et retravaillée. Elle ouvre à Jawdat Fakhreddine, tout au long de sa vie et de l’enfance à la vieillesse, un destin immatériel, sans fin ni but ni mémoire, tout de légèreté, d’innovation et de naissance perpétuelle des formes. La droiture et la morale n’ont plus leur raison d’être : « La forme/le nuage la fait et la dissipe. /Dans les nuages/je vois toutes les formes/et toutes sont là pour se dissiper/et pour soulever la poussière des naissances. /Est-ce là un jeu à voir/pour aller au travail sans désespoir ?/La forme/ c’est ton jeu insensé O nuage. » Le long compagnonnage, fait de complicité et de malentendus, entre la nuée et son ombre pitoyable, le créateur, arrache le poème à l’abstraction, le pourvoit de sa sève nourricière et en font un chef d’œuvre à traduire dans toutes les langues.
Le dernier poème du recueil évoque la mort du père des suites d’une longue maladie. Sans pleurnicherie ni ambivalence œdipienne, avec un art consommé de la litote, le poète dresse un hymne à l’amitié, au bonheur et à l’éternité profane: « Ensemble/ peut être nous souviendrons-nous dans un jour à venir/des ombres d’un soir accueillant nos rencontres/ et nous réunissant pour un temps au préambule perdu/ à un nombre restreint d’amis/au bord d’un jardin ancestral/ Peut être nous souviendrons-nous dans un jour à venir/des ombres d’un soir accueillant un sens de l’amitié/ assumé par la poésie… »
Dans la plus récente de ses œuvres, Jawdat n’oppose pas à un spleen affadi un idéal vague et hors de portée, comme la tentation lui a naguère pris. Se référant plus d’une fois explicitement aux vocables et métaphores d’Imru’ al Qays et de Mutanabbi et les intégrant dans sa poésie sans qu’un écart quelconque ne se creuse, il saisit, dans la réalité même, le champ de l’affirmation de soi, de la joie et de l’espoir. Ce champ bien terrestre est imbu de nuit mais traverse la mort même.
LES VILLES ET LEURS MOTS

On peut estimer trop long le titre d’un ouvrage destiné à servir longtemps de référence et peut être induire que l’intitulé d’un livre doit être inversement proportionnel au nombre de ses pages. Mais cette longueur trouve, sans doute, sa raison d’être dans le double usage qu’on peut faire de cette somme de 264 articles écrits par 160 auteurs pendant plus de dix ans : d’une part, un dictionnaire, quoi qu’en dise le principal maître d’œuvre, auquel se réfèreront tous ceux qui s’intéressent à la ville, à son histoire comme à son présent; d’autre part, un lieu de flâne dans le pays urbain où chacun peut tracer son cheminement propre dans les mots, les espaces, le temps, les langues, les aires culturelles, les nuances décisives et les belles différences.
Partons par exemple du mot français « Place » qu’on trouve à sa place ( !) dans l’ordre alphabétique. Après les définitions des dictionnaires des XVII (particulièrement celle polysémique et riche de Furetière) et du XXème siècles, nous apprenons que le terme, issu du latin et du grec où il signifiait « large », a sa première occurrence française dans La Chanson de Roland (XIIème siècle) et s’est toujours caractérisé par un « flou lexicographique qui…n’a pas manqué d’entretenir les ambiguïtés ». Exemples urbains à l’appui, nous voyons comment cette « dilatation de l’espace contrastant avec le réseau des rues » requérait au Moyen Age la protection d’une réglementation urbaine, municipale ou royale, particulièrement « contre l’envahissement des halles ». Sous Henri IV, la Place Royale (actuelle Place des Vosges), édifiée en 1605, fut conçue pour servir de « proumenoir » aux parisiens et pour les grands rassemblements « aux jours de réjouissance ». Désormais les Places royales (avec lesquelles coexistent des modèles anciens et se développent d’autres nouveaux) ont 3 caractères énumérés par Roger Chartier : 1) elles sont fermées et faiblement raccordées aux rues ; 2) elles sont vouées à une activité ‘publique’ (change, commerce…) ; 3) elles reçoivent après coup une statue du roi. Avec Louis XIV, la Place est d’emblée conçue pour accueillir la statue ; « l’ordonnance de l’espace » se diversifie : le cercle, le demi-cercle et l’octogone succèdent au carré et au rectangle ; la Place reste toutefois à l’écart des grandes voies de circulation. C’est sous Louis XV que les Places commenceront à s’ouvrir et la tendance se parachève sous l’ère Haussmann (Second Empire). Mais à partir du XIX ème siècle, le mot prolifère et les espaces qu’on qualifie de Places « ne sont autre chose que certains élargissements de la voie publique résultant de l’entrecroisement de plusieurs rues(…) » (M. Darin). Le flou du mot et la dévitalisation de la chose expliquent, pour les auteurs de l’article concerné, L. Bauer et J-C. Depaule, que pour les villes et quartiers nouveaux on préfère les termes Parvis, Esplanade, Agora, Forum, Piazza…
Le terme Place avec ses particularités hexagonales ne recouvre ni la Piazza italienne, ni le Platz allemand, ni la Plaza espagnole, ni le Square anglais, ni les correspondants russe ou portugais du mot. Chacune de ces désignations pointe une histoire et des traits originaux. Les vocables voyagent et les emprunts sont continuels, mais les mésusages et les recréations de nouvelles significations ne cessent jamais. Le propre de L’aventure des mots de la ville est de traiter des mots de sept langues européennes - l’allemand, le français, l’italien, le russe, l’espagnol, le portugais, l’anglais, - en accordant leur importance aux variantes américaines pour les trois dernières. L’agréable surprise de l’ouvrage est de retenir l’arabe (et de le retenir seul !) à côté des sept langues européennes en raison de l’intensité des interactions entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Argument décisif, certainement, auquel il faut ajouter probablement la profonde connaissance qu’a de notre région, et de ses villes, l’un des éditeurs de l’ouvrage, l’anthropologue Jean-Charles Depaule, et les nombreuses amitiés qu’il s’y est faites et dont plusieurs se retrouvent au nombre des collaborateurs du livre.
Si on passe au correspondant arabe de Place, le terme Sâha, on retrouve chez le lexicographe de l’époque mamelouk Ibn Manzûr (XIIIe s.), deux des traits de la Place médiévale européenne : une certaine étendue et un espace entre les maisons d’un quartier. L’adoption contemporaine de l’appellation, qu’elle soit d’importation ou de patrimoine, participe de la redéfinition des espaces publics : lieux accessibles à tous et gérés par les pouvoirs publics. Au Caire, on utilise plutôt que Sâha, le mot Maydân (qui a été importé au Yémen où le terme Sarha reste courant) généralement lié aux exercices et joutes équestres, et désormais utilisé comme toponyme à Damas ou ailleurs (Zahlé, Zghorta…) (cf. l’entrée Maydân signée Brigitte Marino). Aussi n’est-il pas étonnant de voir dans l’article Saha, son auteur Depaule se référer à Mahfouz, Abdul Rahman Mounif, Rachid El-Daïf, Chawqi Douaihy.
Le périple entamé pourrait continuer à l’infini, passer par Sûq (Frank Mermier), Zuqâq (Samia Naïm), Dâhiya(Mona Harb), Hayy, Mahalla (Nicolas Puig), Madîna (Jean-Claude David), ‘Asima (A. Moussaoui)…, sortir du domaine arabe pour les langues européennes, il est toujours instructif et, sans jamais tomber dans la facilité, passionnant. Le sociologue, le géographe, l’anthropologue urbain et l’historienne qui ont veillé sur le livre ont réussi le pari de remuer et de refonder les mots que les habitants des villes utilisent dans le quotidien pour définir leur espace et tenter de le changer.
Le seul reproche qu’on peut faire à cet opus, au-delà de points de détails toujours ouverts, c’est son austérité éditoriale et l’absence de toute iconographie. De quoi préférer à ses randonnées celles si animées des villes mêmes.
Tuesday, 11 January 2011
« POUR SALUER UN OISEAU LIBRE » OUNSI EL HAGE et FAYCAL SULTAN

La rencontre d’Ounsi el Hage avec les arts plastiques et notamment la peinture allait de soi et prenait source autant dans sa poésie que dans son rôle capital dans le paysage culturel (il fonda en 1964 Al Mulhaq , le supplément hebdomadaire du journal An Nahar, et le publia jusqu’en 1974 régentant une part importante de la vie des Arts et des Lettres de Beyrouth). Né en 1937, il contribua, à vingt ans, avec Youssef al Khal et Adonis à la fondation de la revue poétique Shi’r. En publiant dans les éditions de cette dernière ses deux premiers recueils, Lan (1960) et La tête coupée (1963), il introduisait le poème en prose dans la langue arabe et se voulait le poète le plus radical du groupe, invoquant l’itinéraire d’Artaud et s’opposant violemment à toutes les formes éprouvées de la tradition.
A partir du milieu des années 1960 et surtout dans la décade qui suit, le « démon de la modernité » devient furtivement le « prophète de l’amour ». L’iconoclasme, la provocation et l’hermétisme des deux premières œuvres font place à un lyrisme rénové par une dimension spirituelle nourrie du Cantique des cantiques (qu’il présenta et redistribua, accompagné d’aquarelles de Paul Guiragossian, Dar annahar, 1967), de la Genèse, et retrouvant la fibre profonde des traditions locales libanaises. Ce changement est net dans Qu’as-tu fait de l’or qu’as tu fait de la rose (1970), mais atteint son plein épanouissement dans La Messagère aux cheveux longs jusqu’aux sources (1975), recueil illustré par le même Guiragossian, et où la Femme accède à une « dimension métaphysique » (Sarane Alexandrian).
La guerre du Liban et ses suites guident le poète vers une phase de désenchantement. Al Walima (Le banquet) (1994), dont Ethel Adnan fit un exemplaire peint superbe, accomplit l’art poétique d’Ounsi el Hage et se ressent douloureusement de l’impasse historique où désormais le pays et la région se trouvent. Un livre de contemplations philosophiques et d’aphorismes en plusieurs volumes suit, Khawatem (Anneaux). La prose de l’auteur est désormais d’une limpidité, d’une concision et d’une intensité classiques.
En février 1999, le peintre Fayçal Sultan, très attentif aux grands penseurs et écrivains arabes et à leurs créations, consacre une exposition entière à la galerie Janine Rubeiz au poète dont il se sent très proche, Ounsi el Hage. Des acryliques sur toile, d’autres sur papier rehaussés d’encre de chine, des lithographies…sont regroupés sous le titre : « Pour saluer un oiseau libre », intitulé par ailleurs d’une des séries. Empruntant à Kandinsky, à Matisse, à Picasso…mais imprégné de la magie de l’Orient, faisant appel à des couleurs pastel, utilisant parfois des phrases du poète non calligraphiées selon les canons officiels pour rester proche du sens, l’artiste cherche à recréer librement le monde du poète, à illustrer les thèmes de la liberté, de l’amour, de la Femme, à ouvrir des voies sur une connaissance plus immédiate et plus directe de textes déjà en guerre contre la rhétorique et le dogmatisme.
LES COMBATS ININTERROMPUS D’ESPRIT

A l’heure où le numéro de décembre 2010 de la revue Esprit n’a pas été mis en vente dans les kiosques parisiens et français suite à un mouvement de grève de l’organisme chargé de sa distribution ainsi que celle de nombreux périodiques, nous tenons à saluer celui de novembre particulièrement riche et au dossier central duquel « Que devient la guerre au Proche-Orient ? » a pris une part active notre collègue à L’Orient littéraire Rita Bassil El Ramy.
Fondée en 1932 par Emmanuel Mounier, père du personnalisme, cette revue intellectuelle « philocommuniste » dans l’après guerre et jusqu’à la mort du fondateur (1950) passa doucement, et sans renier ses affinités fondamentales, d’une identité philosophique bien marquée par un engagement chrétien et des options générales de gauche à la fonction de carrefour des divers courants intellectuels. Dirigée par des noms prestigieux (Albert Béguin, Jean-Marie Domenach, Paul Thibaud), elle sera pour longtemps (nous n’osons pas dire « toujours », vu les aléas de l’édition et les incertitudes du « livre ») associée au travail de pensée de Paul Ricoeur qui l’associa à ses prises de position intellectuelles en y écrivant régulièrement.
Depuis 1989, Olivier Mongin dirige Esprit et lui imprime un dynamisme hors pair qui la place au cœur des débats intellectuels les plus importants de notre époque et la remonte dans les chiffres de ventes (elle imprime deux fois plus que lors de sa prise en charge, frôlant les 10,000 exemplaires). On ne voudrait pour preuve de sa vigueur que le nombre de ses articles dans un même numéro, la diversité des champs dont il traite (le rire, le cinéma, l’urbanisme… en sus de l’engagement pour les libertés et contre toutes les formes de ségrégation, d’inégalité sociale et d’oppression) et surtout les vertus d’une pensée honnête, intégratrice et innovante. Comme l’amitié est au cœur de la réussite d’une revue intellectuelle, on ne peut passer sous silence la qualité de la sienne et le rôle important qui revient à ses amis dans le combat éditorial et social.
Le point de départ du dossier proche-oriental, pivot du numéro de novembre, est le constat suivant : « Comme on observe plus que jamais un enchevêtrement de situations locales, nationales, régionales et internationales, on en conclut facilement à l’immobilisme des acteurs locaux tout en attendant la prochaine explosion comme une fatalité.» Pour refuser la démission intellectuelle et éthico-politique, et pour réaffirmer que « le Proche-Orient n’est pas une terre condamnée à la guerre et à la théocratie mais un espace historique où la politique doit retrouver un sens », le dossier cherche à ouvrir trois perspectives : montrer le changement des rapports intervenu entre les protagonistes et à l’intérieur de chacun d’eux suite notamment à la modification de la nature de la guerre (fin de l’idée d’une « guerre propre » du coté israélien (Roger Nabaa), nouveau rôle primordial des populations civiles (A. Margalit et Michael Walzer), changement du rapport des forces et des formes de confrontation); retour sur le passé opéré par les historiens (très intéressante confrontation entre Henry Laurens et Avi Shlaim) et par des hommes de lettres d’une grande sensibilité (Elias Sanbar commente finement son Discours amoureux de la Palestine et redonne aux mots un sens capital « plus pur », en attendant les retrouvailles totales des peuples libanais et palestinien auxquelles il ouvre la voie); évocation du problème de la reconstruction de l’Etat au Liban (Samir Frangié), question souvent éludée mais incontournable pour l’avenir de toute la région.
Les revues papier ont-elles un avenir? Les tirages actuels de revues aussi prestigieuses que La Nouvelle Revue française, Critique, Annales …sont loin de laisser optimistes. Le numéro d’Esprit montre comment on peut prendre le taureau par les cornes et contribuer utilement à un débat qui ne cesse d’ensanglanter et d’empoisonner la scène mondiale depuis près d’un siècle. Mais l’indépendance sur le plan économique et rédactionnel n’est pas sans risques à l’heure des spectacles et des mascarades germanopratins. Ne nous contentons pas donc de vœux pieux et offrons, comme nous le suggère la rédaction de la revue des « cadeaux sérieux » : un abonnement couplé papier et revue en ligne.
Saturday, 4 December 2010
LA PERRENITE DE LA MAISON MESSARRA

On sort du dernier livre d’Antoine Messarra comme d’une musique du chambre ; ou peut être faudrait-il dire musique de maison, vue la place de cette dernière (à la fois bâtisse et maisonnée) dans l’ouvrage. On est dérangé, certes, par de nombreuses cacophonies : le fait que l’ouvrage se présente comme copie conforme d’une série sociopolitique dont l’énumération des seuls titres tient en huit pages ; les répétitions non seulement d’un écrit à l’autre, mais à l’intérieur d’un même texte ; les quelques inexactitudes que seule peut expliquer la hâte (le Cénacle libanais ne se situait pas « à la place Béchara el-Khoury » ; Ce n’est pas d’Avicenne qu’il est question dans Al Massir de Chahine…) ; mais surtout le fait de n’avoir pas refondu des pages éparses en une synthèse littéraire à la mesure du contenu et de n’avoir pas amené le tout au niveau de ses intensités maximales et nombreuses. Mais ces réserves ne sont que des taches d’ombre dans la lumière d’un témoignage de haute envolée sur soi, sa culture, sa foi, sa famille, sa maison, Beyrouth…Le théoricien du consensus et de la société de concordance donne ici la parole à l’individu en dialogue avec sa propre personnalité et engagé dans ses réseaux familiaux et urbains. Cela nous donne l’opportunité de lumières nouvelles, de liens nouveaux et d’un vrai plaisir du texte, voire d’une conversation avec des digressions, des analyses, des détails piquants, des anecdotes historiques.
Des écrits spéculatifs à la confession personnelle, la distance n’est évidemment pas énorme et on retrouve dans le vécu d’Antoine les lignes directrices du style de pensée de Messarra. L’auteur par ailleurs affirme que le « récit de vie » devrait être une « méthode privilégiée dans les sciences humaines » surtout en ce qui concerne « le lien social ». Mais si la sérénité, l’optimisme et l’insistance sur les aspects positifs du devenir historique trouvent leurs homologues dans la convivialité beyrouthine, pouvait-on soupçonner certains événements tragiques du destin de l’auteur (mort de sa jeune mère alors qu’il n’a que 8 ans ; décès de son père lorsqu’il est en classe de 4ème …) ?
Au-delà d’une enfance vécue à l’ombre d’un père employé à la Compagnie du port de Beyrouth et dont il égrène les souvenirs, de la fréquentation d’un café au bord de la mer à l’approvisionnement en fruits et légumes à Souk Nourié, l’auteur est attentif à la vie d’un quartier qu’on appelait , dans les années 1920, le quartier Messarra et qui prend place entre l’église du Saint Sauveur et le petit collège des jésuites. Il surveille tout ce qui s’y passe : la disparition des petites boutiques de quartier qui affaiblit la civilité, le changement de fonction des balcons…Mais ce sur quoi porte essentiellement son attention, c’est cette résidence de la rue Abd el-Wahab el-Inglizi située à cinquante mètres de la ligne de 1a ligne de démarcation des années 1975-1990, mais ignorante des divisions « visibles et mortelles » qui déchiraient Beyrouth ou tentaient vainement de le faire. Cette maison s’ancre dans la durée et six générations de Messarra, depuis la fin du XIXème, s’y sont installées. La confiance d’Antoine est telle qu’il inclut dans son énumération deux générations du futur : ses enfants et ses petits enfants. Cette résidence est, en outre, « l’œuvre des femmes »et on ne peut qu’être sensible aux nombreux témoignages d’amour d’Antoine à Evelyne, véritable âme du foyer.
Beyrouth, cité conviviale par excellence, intègre et rassemble mais n’en est pas moins menacée par sa réussite (déplacement des cimetières et disparition des jardins publics ?) comme par les groupes qu’elle n’est pas parvenue à s’assimiler et qui pourraient casser la ville ou la multiplier. On comprend l’irritation d’Antoine Messarra face à ceux qu’il appelle des « hordes » ou des « étrangers », mais on ne peut que noter que trop nostalgique en ce qui concerne le passé de sa ville, il se trouve ici en porte à faux quant à sa puissance d’intégration.
Nous n’avons pu passer en revue qu’une partie de cet ouvrage extrêmement riche où on lira des textes délicieux sur Bach, Descartes, Sainte Thérèse de Lisieux… Qu’il nous suffise de signaler les multiples fonctions qu’y revêt l’écriture : un acte de « gratitude», un chemin de « droiture », un « exercice nécessaire de citoyenneté et d’urbanité »…
LA SPLENDEUR DES SURSOCK

Dominique Fernandez: Palais Sursock Beyrouth, Préface de Yvonne Sursock Lady Cochrane, Photographies de Ferrante Ferranti et Mathieu Ferrier, Philippe Rey, Paris, 2010.
Il est une phrase de ce somptueux ouvrage qui fait courir un froid dans le dos : « Dieu seul sait ce qu’il adviendra de cette propriété, encerclée de plus en plus par d’ignobles tours(…)Elle constitue encore le seul espace vert du quartier(…)Mais elle demeurera dans le souvenir de ceux qui l’ont connue, l’image d’une époque où la civilisation et l’art de vivre faisaient partie du quotidien. » Elle figure aux dernières lignes de la préface de Lady Cochrane, héritière en troisième génération du domaine, et dont, depuis des décennies, « l’extraordinaire vitalité se fond miraculeusement dans le silence moelleux de sa demeure… », comme dit Dominique Fernandez dans un texte où l’envoûtement quasi religieux ne gomme jamais l’esprit critique. On pensait le livre un No Trepassing, serait-il un Adieu ou un prélude à Autant en emporte la Spéculation ? Les Libanais assisteront-ils comme à une fatalité, dans quelques décades ou quelques années, à la disparition du plus prestigieux palais de Beyrouth ou sauront-ils, Etat et citoyens ensemble, le défendre becs et ongles ? Ce livre est le meilleur plaidoyer pour une maison et un jardin qui, pour avoir été longtemps réservés à une élite, sont désormais inscrits au patrimoine de chacun.
Les Sursock n’appartenaient pas aux 7 familles, plus ou moins légendaires et toutes grecques orthodoxes, de Beyrouth. On relate même qu’à l’origine, on les snoba. Mais ils s’imposèrent vite comme les plus munificents, les plus attachés aux arts et aux raffinements de la vie et de la culture, et ils donnèrent leur nom au plus aristocratique quartier d’Achrafieh. Recevant les puissants de l’empire ottoman et du mandat français, ils eurent cette singularité au Liban de ne point s’occuper directement de politique (cela les conduisit, par contre, à « l’irresponsabilité » dans la vente des terres en Palestine ). Mais ils utilisèrent leurs relations pour prendre directement en main la municipalité de Sofar et donner à ce village un plan directeur qui, un siècle plus tard, en fait l’une des plus belles villégiatures de la Montagne.
Le Palais fut construit en 1850 par Moussa Sursock (1815-1886) qui s’y installa retour d’Egypte, sur les instances de son épouse Anastasia Dagher. Bâti sur une ancienne nécropole et donnant de haut sur la Méditerranée, il serait l’œuvre de maîtres maçons et non de grands architectes, ce que mettent en doute certains éléments de construction importés, en l’absence d’archives. Blanc à l’origine comme on le voit sur les photos de l’Avant guerre mondiale, Donna Maria Serra de Cassano, épouse Alfred Sursock, et mère de l’actuelle propriétaire, l’a fait recouvrir d’un enduit brun. Concentrée sur un hectare, la propriété réunit la presque totalité de la flore méditerranéenne.
La maison vaut moins par les chefs d’œuvre artistiques qu’elle recèle (a l’exception des Daoud Corm, Habib Srour, Alfred Sursock…la plupart des toiles sont de l’école de… ou attribuées à…) que par une atmosphère unique où les tapis de Turquie et de Perse, les tapisseries des Flandres, les boiseries de Damas, les cristaux de Bohême, les plafonds et les colonnades…dégagent une harmonie dont se sont nourries, sans l’égaler, la plupart des belles demeures libanaises. Fernandez affirme qu’elle fait penser à Henry James par son côté « feutré, mystérieux, crépusculaire » et à Marcel Proust pour la haute noblesse et la domesticité. Mais d’autre références plus justes seraient à trouver.
Il faut rendre enfin hommage à la photographie de Ferrante Ferranti et de Mathieu Ferrier pour le détail et le jeu de lumière de leurs prises. Comme il faut dire le plus grand bien du chemin de fer de Louise Brody (Conception et mise en page) qui vous familiarise avec une architecture complexe et vous guide par la main dans son dédale. Vous pénétrez par la porte sud qui donne sur la rue et vous montez les étages pour retrouver la façade Nord qui donne sur le jardin et la mer. Quant à l’escalier central, il ne peut qu’évoquer le film de Welles, The Magnificent Ambersons et toute la symbolique baroque à laquelle il s’attache.
Les Sursock qui ont tant fait pour aider les Libanais à se définir dans leurs goûts méritent qu’on défende vigoureusement leur patrimoine.
L’IMAGINAIRE FRANÇAIS AU DÉFI DU LEVANT
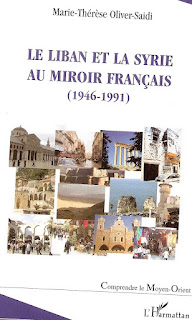
Mais si le projet général est séduisant, nombre de ses fragments sont délicieux. On en voudra, pour preuve, la partie consacrée au Liban des années 1960 à travers une dizaine de romans policiers parus à l’époque. Au-delà ou en deçà des stéréotypes nombreux et du pittoresque tape à l’œil, l’auteure cherche à la suite d’Umberto Eco, le « réseau d’associations élémentaires » et la « dynamique profonde et originelle » qui sous-tendent l’intrigue. Ainsi passe-t-elle en revue la description que donnent ces œuvres des paysages, leur perception de Beyrouth et de ses ruptures urbaines, leur utilisation des « lieux » comme vecteurs de dépaysement et comme théâtre d’épreuves. « Souks, palais, bains, leur présence consacre l’appartenance reconnue du pays à l’Orient. Elle investit aussi bien l’organisation de l’espace que la représentation sociale, le rapport au temps à l’argent ou au corps ». Cette litanie orientale est, par ailleurs, un maillon entre les vestiges antiques et les points modernes (casinos, banques, cabarets…) Les personnages ne sont pas oubliés où s’affirment les communautés et leurs tropismes, les affaires plus ou moins louches, l’élément féminin dans sa dichotomie orientale (la sultane et l’esclave). Le roman policier fait en définitive ressortir, à travers ses clichés et sur fond de lutte Est-Ouest, un Liban complexe et plus d’une œuvre (celles de Jean Bruce en particulier) devient une parodie de voyage en Orient et de quête initiatique.
Malheureusement l’ouvrage recèle de nombreuses erreurs qui portent leur ombre sur une aussi vaste entreprise. Passe encore le fait de confondre systématiquement Jean Grenier (auteur d’Un été au Liban) et Roger Grenier, de renvoyer à un article de Chiha paru dans L’Orient ; mais que dire de «en 1947, le patriarche maronite de Beyrouth, Mgr Hayek » (erreurs sur la fonction et le titulaire) ? ou « des articles de Georges Naccache dans Al-Nahar » ? ou de Georges Schehadé formé à l’Ecole Supérieure des Lettres ??!! (et quelle distorsion pour son œuvre poétique parue en grande partie dans les années 1930 et 1940 et qui n’a jamais prononcé le mot Liban de la voir ravalée à un miroir de ce pays durant les années 1960 ?)
Mais là où le « miroir français »se brise, c’est quand, sans justification sérieuse, le témoignage des autochtones, écrivant en français ou même en arabe, lui est annexé et que les romans et recueils des Syriens et surtout des Libanais prennent dans le livre une place prépondérante.
L’ouvrage compte certes des faiblesses, il n’en demeure pas moins une contribution importante à l’histoire du rapport des 3 peuples et se lit avec un plaisir certain.
