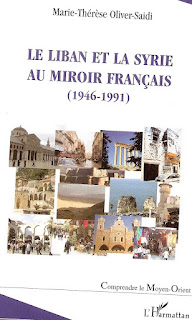Antoine Nasri Messarra: Leçons particulières, Souvenirs et récits de vie, 379pp, Librairie orientale, Beyrouth, 2010.
On sort du dernier livre d’Antoine Messarra comme d’une musique du chambre ; ou peut être faudrait-il dire musique de maison, vue la place de cette dernière (à la fois bâtisse et maisonnée) dans l’ouvrage. On est dérangé, certes, par de nombreuses cacophonies : le fait que l’ouvrage se présente comme copie conforme d’une série sociopolitique dont l’énumération des seuls titres tient en huit pages ; les répétitions non seulement d’un écrit à l’autre, mais à l’intérieur d’un même texte ; les quelques inexactitudes que seule peut expliquer la hâte (le Cénacle libanais ne se situait pas « à la place Béchara el-Khoury » ; Ce n’est pas d’Avicenne qu’il est question dans Al Massir de Chahine…) ; mais surtout le fait de n’avoir pas refondu des pages éparses en une synthèse littéraire à la mesure du contenu et de n’avoir pas amené le tout au niveau de ses intensités maximales et nombreuses. Mais ces réserves ne sont que des taches d’ombre dans la lumière d’un témoignage de haute envolée sur soi, sa culture, sa foi, sa famille, sa maison, Beyrouth…Le théoricien du consensus et de la société de concordance donne ici la parole à l’individu en dialogue avec sa propre personnalité et engagé dans ses réseaux familiaux et urbains. Cela nous donne l’opportunité de lumières nouvelles, de liens nouveaux et d’un vrai plaisir du texte, voire d’une conversation avec des digressions, des analyses, des détails piquants, des anecdotes historiques.
Des écrits spéculatifs à la confession personnelle, la distance n’est évidemment pas énorme et on retrouve dans le vécu d’Antoine les lignes directrices du style de pensée de Messarra. L’auteur par ailleurs affirme que le « récit de vie » devrait être une « méthode privilégiée dans les sciences humaines » surtout en ce qui concerne « le lien social ». Mais si la sérénité, l’optimisme et l’insistance sur les aspects positifs du devenir historique trouvent leurs homologues dans la convivialité beyrouthine, pouvait-on soupçonner certains événements tragiques du destin de l’auteur (mort de sa jeune mère alors qu’il n’a que 8 ans ; décès de son père lorsqu’il est en classe de 4ème …) ?
Au-delà d’une enfance vécue à l’ombre d’un père employé à la Compagnie du port de Beyrouth et dont il égrène les souvenirs, de la fréquentation d’un café au bord de la mer à l’approvisionnement en fruits et légumes à Souk Nourié, l’auteur est attentif à la vie d’un quartier qu’on appelait , dans les années 1920, le quartier Messarra et qui prend place entre l’église du Saint Sauveur et le petit collège des jésuites. Il surveille tout ce qui s’y passe : la disparition des petites boutiques de quartier qui affaiblit la civilité, le changement de fonction des balcons…Mais ce sur quoi porte essentiellement son attention, c’est cette résidence de la rue Abd el-Wahab el-Inglizi située à cinquante mètres de la ligne de 1a ligne de démarcation des années 1975-1990, mais ignorante des divisions « visibles et mortelles » qui déchiraient Beyrouth ou tentaient vainement de le faire. Cette maison s’ancre dans la durée et six générations de Messarra, depuis la fin du XIXème, s’y sont installées. La confiance d’Antoine est telle qu’il inclut dans son énumération deux générations du futur : ses enfants et ses petits enfants. Cette résidence est, en outre, « l’œuvre des femmes »et on ne peut qu’être sensible aux nombreux témoignages d’amour d’Antoine à Evelyne, véritable âme du foyer.
Beyrouth, cité conviviale par excellence, intègre et rassemble mais n’en est pas moins menacée par sa réussite (déplacement des cimetières et disparition des jardins publics ?) comme par les groupes qu’elle n’est pas parvenue à s’assimiler et qui pourraient casser la ville ou la multiplier. On comprend l’irritation d’Antoine Messarra face à ceux qu’il appelle des « hordes » ou des « étrangers », mais on ne peut que noter que trop nostalgique en ce qui concerne le passé de sa ville, il se trouve ici en porte à faux quant à sa puissance d’intégration.
Nous n’avons pu passer en revue qu’une partie de cet ouvrage extrêmement riche où on lira des textes délicieux sur Bach, Descartes, Sainte Thérèse de Lisieux… Qu’il nous suffise de signaler les multiples fonctions qu’y revêt l’écriture : un acte de « gratitude», un chemin de « droiture », un « exercice nécessaire de citoyenneté et d’urbanité »…
On sort du dernier livre d’Antoine Messarra comme d’une musique du chambre ; ou peut être faudrait-il dire musique de maison, vue la place de cette dernière (à la fois bâtisse et maisonnée) dans l’ouvrage. On est dérangé, certes, par de nombreuses cacophonies : le fait que l’ouvrage se présente comme copie conforme d’une série sociopolitique dont l’énumération des seuls titres tient en huit pages ; les répétitions non seulement d’un écrit à l’autre, mais à l’intérieur d’un même texte ; les quelques inexactitudes que seule peut expliquer la hâte (le Cénacle libanais ne se situait pas « à la place Béchara el-Khoury » ; Ce n’est pas d’Avicenne qu’il est question dans Al Massir de Chahine…) ; mais surtout le fait de n’avoir pas refondu des pages éparses en une synthèse littéraire à la mesure du contenu et de n’avoir pas amené le tout au niveau de ses intensités maximales et nombreuses. Mais ces réserves ne sont que des taches d’ombre dans la lumière d’un témoignage de haute envolée sur soi, sa culture, sa foi, sa famille, sa maison, Beyrouth…Le théoricien du consensus et de la société de concordance donne ici la parole à l’individu en dialogue avec sa propre personnalité et engagé dans ses réseaux familiaux et urbains. Cela nous donne l’opportunité de lumières nouvelles, de liens nouveaux et d’un vrai plaisir du texte, voire d’une conversation avec des digressions, des analyses, des détails piquants, des anecdotes historiques.
Des écrits spéculatifs à la confession personnelle, la distance n’est évidemment pas énorme et on retrouve dans le vécu d’Antoine les lignes directrices du style de pensée de Messarra. L’auteur par ailleurs affirme que le « récit de vie » devrait être une « méthode privilégiée dans les sciences humaines » surtout en ce qui concerne « le lien social ». Mais si la sérénité, l’optimisme et l’insistance sur les aspects positifs du devenir historique trouvent leurs homologues dans la convivialité beyrouthine, pouvait-on soupçonner certains événements tragiques du destin de l’auteur (mort de sa jeune mère alors qu’il n’a que 8 ans ; décès de son père lorsqu’il est en classe de 4ème …) ?
Au-delà d’une enfance vécue à l’ombre d’un père employé à la Compagnie du port de Beyrouth et dont il égrène les souvenirs, de la fréquentation d’un café au bord de la mer à l’approvisionnement en fruits et légumes à Souk Nourié, l’auteur est attentif à la vie d’un quartier qu’on appelait , dans les années 1920, le quartier Messarra et qui prend place entre l’église du Saint Sauveur et le petit collège des jésuites. Il surveille tout ce qui s’y passe : la disparition des petites boutiques de quartier qui affaiblit la civilité, le changement de fonction des balcons…Mais ce sur quoi porte essentiellement son attention, c’est cette résidence de la rue Abd el-Wahab el-Inglizi située à cinquante mètres de la ligne de 1a ligne de démarcation des années 1975-1990, mais ignorante des divisions « visibles et mortelles » qui déchiraient Beyrouth ou tentaient vainement de le faire. Cette maison s’ancre dans la durée et six générations de Messarra, depuis la fin du XIXème, s’y sont installées. La confiance d’Antoine est telle qu’il inclut dans son énumération deux générations du futur : ses enfants et ses petits enfants. Cette résidence est, en outre, « l’œuvre des femmes »et on ne peut qu’être sensible aux nombreux témoignages d’amour d’Antoine à Evelyne, véritable âme du foyer.
Beyrouth, cité conviviale par excellence, intègre et rassemble mais n’en est pas moins menacée par sa réussite (déplacement des cimetières et disparition des jardins publics ?) comme par les groupes qu’elle n’est pas parvenue à s’assimiler et qui pourraient casser la ville ou la multiplier. On comprend l’irritation d’Antoine Messarra face à ceux qu’il appelle des « hordes » ou des « étrangers », mais on ne peut que noter que trop nostalgique en ce qui concerne le passé de sa ville, il se trouve ici en porte à faux quant à sa puissance d’intégration.
Nous n’avons pu passer en revue qu’une partie de cet ouvrage extrêmement riche où on lira des textes délicieux sur Bach, Descartes, Sainte Thérèse de Lisieux… Qu’il nous suffise de signaler les multiples fonctions qu’y revêt l’écriture : un acte de « gratitude», un chemin de « droiture », un « exercice nécessaire de citoyenneté et d’urbanité »…